.
Qui peut résister à Isabelle Eberhardt après l’avoir découverte ? La nouvelle bio-fiction de Tiffany Tavernier, chez Tallandier, confirme la règle qu’on ne plonge pas impunément dans l’aventure de celle que les prédécesseurs en biographie ont, tour à tour, nommée, « la bonne nomade », « une Russe au désert », « La Louise Michel du Sahara », « la Révélation du Sahara », « l’amazone des sables », « l’errante », « une rebelle », « une Maghrébine d’adoption », « Nomade », « Isabelle l’Algérien », « Si Mahmoud »… Dans La couronne de sable, Françoise d’Eaubonne suggérait même qu’elle serait la fille de Rimbaud… Entre document, fantasme et reconstitution, la vie d’Isabelle Eberhardt fait rêver. En ces temps où l’islam est au banc des accusés, il peut être intéressant de relire sa vie et surtout de lire ses textes et de comprendre, des uns aux autres, cette quête profonde pour construire son identité hors des chemins de sa naissance.
.
.
Le travail d’écriture d’une biographie est réalisé avec beaucoup d’empathie et de « mentir-vrai » par Tiffany Tavernier. Empathie car, comme le dit la 4è de couverture, pour elle la découverte d’Isabelle Eberhardt fut une révélation. « Mentir-vrai » car elle ne laisse aucun silence entre les intervalles silencieux des faits attestés de sa vie. Elle donne comme certaine une filiation qui ne l’est pas et a fait couler beaucoup d’encre et surtout, elle nous installe dans l’intimité de la jeune fille puis de la jeune femme en puisant abondamment dans ses écrits qui deviennent ainsi tous autobiographiques. Il est certain que chez Isabelle Eberhardt, vie et œuvre sont intimement liés mais peut-être pas au point que la seconde soit un simple reflet de la première. Toutes les références sont données mais le récit en fondu enchaîné ne permet pas de distinguer entre le fait biographique et la reconstitution imaginée. Cela donne un ouvrage très enlevé, qu’on lit d’un trait avec carte, bibliographie fournie et glossaire ainsi qu’un cahier central de photographies. Les lecteurs familiers de cette figure étonnante seront reconnectés avec bonheur ; d’autres pourront la découvrir en cette période de cadeaux où les livres ont une bonne place ! Le sous-titre peut être aussi une incitation, en écho à la photo d’Isabelle en costume arabe d’apparat, « Un destin dans l’islam », une des dominantes de ce récit biographique. L’intérêt de cette biographie fictionnalisée est d’inventer au plus près des livres déjà écrits sur ou par Isabelle Eberhardt en donnant
l’illusion de partager ses émois, ses épreuves et ses émerveillements.
.
.
Par rapport à l’énorme biographie réalisée par Edmonde Charles-Roux, avec l’aide de quelques autres, il n’y a pas gonflement de la vie elle-même de l’héroïne par la sollicitation d’événements de l’époque plus ou moins rattachés à son destin : un ton enlevé, une sobriété et une complicité font de cette nouvelle biographie une incitation à la connaître. Il est illusoire de vouloir lire tout ce qui s’est écrit sur elle. Toutefois nous signalons la biographie écrite par Khelifa Benamara, en 2005, aux éditions Barzakh à Alger, présentée ainsi par ses éditeurs : « né dans l’habitation même où elle mourut, K.B. nous livre une biographie captivante ». La couverture est sensiblement la même que celle de Tiffany Tavernier.
.
.
Il semble difficile de parler de l’Algérie au tournant des XIXe et XXe siècles sans évoquer cette figure emblématique. Scandaleuse pour les uns, fascinante pour les autres, la brièveté de sa vie ajoute encore une aura de mystère et d’inachevé propice au rêve, au fantasme, à l’invention. Toujours inclassable, elle est une femme « aux semelles de vent »…, inversant les perspectives, en cherchant la voie qui, de la compréhension de l’autre et de sa quasi-immersion en lui, dans sa religion, ses coutumes et sa langue, au début d’un siècle algérien « très » colonial, la reconduisait vers la vérité d’elle-même qu’elle n’a cessé de sonder.
.
Isabelle Eberhardt
Dans les biographies, une image revient avec prédilection, celle d’une jeune femme déguisée en homme, chevauchant les étendues désertiques et signant de divers pseudonymes masculins mais dont le plus fréquent est Mahmoud Saadi. Quand elle fut expulsée d’Algérie, le chancelier du consulat de Russie à Alger lui écrit le 18 juin 1901 : « Vous portiez un costume arabe masculin, chose qui, avouez-le vous-même, ne convient pas trop à une demoiselle de nationalité russe »… Elle est ce « trimadeur », titre qu’elle donne à son roman resté inachevé, terme qui n’a pas de féminin ! Terme masculin, terme populaire, il ne peut que plaire à celle qui a plongé autant qu’elle le pouvait dans les sphères des plus défavorisés de la société coloniale d’alors et des habitants du grand sud. Les éditions Cérès à Tunis l’ont réédité en poche en 1997, soulignant qu’il a accompagné la jeune femme et bruisse donc de ses étapes de vie : « Bien plus qu’une tentative biographique transposée, Trimardeur apparaît comme le miroir romanesque du cheminement d’Isabelle Eberhardt. Véritable obsession, son élaboration incessante accompagne (…) la destinée tumultueuse de l’écrivain nomade ».
Si l’exil est voyage, la naissance d’Isabelle, le 17 février 1877 à Genève, d’une exilée russe et de père inconnu, s’inscrit sous ce signe. Deuxième signe du voyage : être enfant naturelle, ce qui ouvre à toute la « mobilité » identitaire qui sera la sienne. Ses années d’enfance et d’adolescence qu’elle a présentées dans ses lettres et ses Journaliers sous un jour très favorable, se passent à Genève, dans un milieu peu conventionnel, à la « Villa neuve » : elle y est choyée et son éducation, rude néanmoins, est originale par rapport aux canons de l’époque. Lorsqu’elle en sort, c’est pour se mêler aux milieux immigrés puisque Genève est alors l’asile des réfugiés politiques de l’Europe et des jeunes Turcs, chassés de leur pays par des pouvoirs autocratiques islamiques. Elle reçoit une éducation libertaire – son précepteur (père ?) Trophimowsky est un disciple de Bakounine –, qui peut expliquer de nombreuses caractéristiques de ses aspirations et de ses principes ; c’est aussi un milieu étouffant, sans doute à cause du caractère dominateur de Trophimowsky et dont elle va aspirer à se libérer. Lorsqu’attaquée par les petits esprits de la colonie, elle écrit dans un article autobiographique où elle lève le voile sur sa personnalité, en 1903 : « Telle est ma vraie vie, celle d’une âme aventureuse, affranchie de mille petites tyrannies, de ce qu’on appelle les usages, le « reçu »… et avide de vie au grand soleil changeante et libre ». Attirée par les pays musulmans d’Orient, son choix pour l’Algérie a été, sans doute induit par l’engagement, en 1894 de son demi-frère Augustin dans la Légion étrangère à Sidi Bel-Abbès.
Le premier séjour d’Isabelle Eberhardt, sur le sol algérien date de mai 1897, lorsque sa mère et elle s’installent à Bône (actuelle Annaba). C’est son premier séjour long, de sept mois, jusqu’à la mort de sa mère, le 28 novembre 1897. Assez rapidement après, elle fait son premier séjour en Tunisie et une petite incursion dans le Sahara. Les questions d’héritage la conduisent à nouveau à Genève et le 15 mai 1899, Alexandre Trophimowsky, « Vava », meurt.
S’ouvre alors son second séjour au Maghreb : l’été 1899 la trouve entre Tunis et Timgad, Biskra, Touggourt. Elle fait un séjour d’une semaine, à la fin du mois d’août dans les Aurès et retourne à Tunis au début septembre. Ce second séjour aura duré 4 mois à peu près. De l’automne 1899 à la fin du mois de juillet 1900, elle retourne en Europe : Marseille, Paris et La Sardaigne. De fin janvier à avril 1900 elle fait des déplacements à Paris, à Genève (les 7 mai, 8 juin, 14 juillet). Elle est à Marseille du 15 au 20 juillet.
Le troisième séjour d’Isabelle Eberhardt commence à Alger, le 22 juillet 1900 ; elle n’y reste qu’une semaine et part très vite à El Oued. L’arrivée dans cette ville du Souf est datée du 4 août 1900 et elle rencontre, peut-être le 6, Sliméne Ehni, maréchal des logis des spahis qui devient son compagnon. D’août à février, donc sept mois, elle y réside. Mais le 29 janvier 1901, Isabelle, initiée à la confrérie des Quadriya, est blessée à Behima par un membre de la confrérie des Tidjania de Guémar et est hospitalisée à El Oued. Après la période la plus lumineuse et apaisée de son existence, elle entre dans une séquence sombre qui a des répercussions sur son couple puisque Slimane est muté à Batna où elle le rejoint, le 25 février 1901, après les soins reçus. On lui conseille d’attendre son procès en France et elle repart à Marseille, chez son frère Augustin où elle ne se plaît pas.
Son quatrième séjour est entièrement consacré au procès de son agresseur : elle arrive à Constantine, le 4 juin 1901 et, à l’issue du procès où elle plaide pour la clémence pour son agresseur, elle est expulsée d’Algérie, le 18 juin. Ce quatrième séjour fut particulièrement court et éprouvant car la publicité du procès l’a livrée à la vindicte et à la malveillance du milieu colonial. Du 4 au 18 juin 1901, elle a donné des articles sur l’attentat et le procès dans La Dépêche algérienne. Dans l’un d’eux : « Je tiens à déclarer ici que je n’ai jamais été chrétienne, que je ne suis pas baptisée et que, quoique sujette russe, je suis musulmane depuis fort longtemps ». Le 20 juin, elle doit quitter l’Algérie et se retrouve à Marseille où Slimène la rejoint le 28 août. Ils se marient le 17 octobre 1901.
Son cinquième séjour en Algérie est le retour tant attendu car elle a vécu l’année 1901 comme un véritable exil de sa terre : désormais française par son mariage avec Slimène Ehni, Isabelle Eberhardt n’est plus sous le coup de l’expulsion ! Le 15 janvier 1902, elle arrive à Bône. Elle se rend à Alger où elle fait la connaissance des Barrucand.
Elle qui a toujours voulu exercer son métier de journaliste, est grandement aidée par cette amitié. Barrucand lui ouvre les portes de L’Akhbar et elle continue à publier des nouvelles dans différents organes de presse. Ces publications éparpillées sont les meilleures garanties pour l’édition de son œuvre future puisque, de son vivant, elle n’a jamais publié d’ouvrage. Cette activité de reporter ainsi que son besoin de voyager font qu’elle se déplace beaucoup. Fin juin-début juillet, elle visite la zaouïa d’El Hamel à Bou Saâda où elle rencontre Lalla Zeynab, une maraboute pour laquelle elle aura une grande admiration. Le 7 juillet, elle s’installe à Ténès où Slimane a été nommé Khodja à la Commune mixte. Elle y fait la connaissance de Robert Randau.
L’atmosphère de Ténès est telle qu’elle fait de fréquents voyages à Alger et ailleurs ; ainsi le 26 janvier 1903, elle est à nouveau à Bou Saâda et à la zaouïa d’El Hamel pour retrouver le calme et la paix auprès de Lalla Zeynab. En avril 1903, elle est accusée par L’Union Républicaine de fomenter des exactions dans les douars et d’avoir des actions anti-françaises, à Ténès. Slimène Ehni est contraint de démissionner. C’est alors qu’elle fait paraître, le 27 juillet 1903, l’article autobiographique dans La Petite Gironde. En septembre 1903, le journal, La Dépêche algérienne l’envoie faire une tournée dans le Sud Oranais. C’est lors de ce périple, en octobre 1903, qu’elle fait la connaissance de Lyautey. Elle passe l’hiver à Figuig. En mai 1904 : elle part pour le sud-ouest et passe l’été à Aïn Sefra, Colomb Béchar et à la zaouïa de Kenadsa. Mais à la fin de l’été, malade, elle renonce à partir plus au Sud et rentre à Aïn Sefra où elle est hospitalisée.
Le 21 octobre 1904, elle sort de l’hôpital et rejoint Slimène dans une maison qu’elle a louée au bord de l’oued. Mais une crue subite de l’oued l’ensevelit sous les décombres ; Slimène parvient à s’enfuir. Le corps d’Isabelle est retrouvé deux jours plus tard et est enterré au cimetière musulman. Près du corps, dans la maison, est retrouvé un sac contenant des manuscrits plus ou moins endommagés par la boue et qui sont confiés à Barrucand. Le cinquième séjour d’Isabelle Eberhardt a duré 21 mois. Il semble qu’alors, son installation était définitive, si tant est qu’on puisse parler de définitif avec Isabelle Eberhardt.
Ainsi, les séjours d’Isabelle Eberhardt ont tous été assez différents : le premier, avec sa mère, la familiarise avec le pays et où elle vit d’une vie citadine totalement atypique pour l’époque, dans les quartiers musulmans et une liaison amoureuse tumultueuse. Le second séjour est plutôt une quête à la recherche de quelque chose qu’elle ne nomme pas encore. Le troisième est celui de sa réalisation, à la fois en tant qu’amante découvrant avec Slimène un amour qui la comble, en tant qu’adepte d’une confrérie et en conformité avec la vie de misère et de nomadisme qu’elle veut sienne. Il n’est interrompu qu’à cause de l’attentat et du procès. Le quatrième séjour, de quinze jours, le plus bref et le plus désespérant, est celui du procès. Enfin, le cinquième séjour est celui de l’installation définitive dans le pays avec des déplacements assez nombreux et la conviction que semble avoir trouvé la jeune femme de son lieu, du mode de vie auquel elle aspire et de la nécessité de l’écriture, tant littéraire que journalistique.
Le voyage de vie d’Isabelle Eberhardt prend racine dans le déplacement familial et se développe dans une recherche existentielle qui dépasse largement les années algériennes, somme toute brèves en termes de décompte temporel. Avec ce rappel biographique, le plus important n’est-il pas de la lire ?… Trois directions peuvent être suivies, non exclusives d’autres : son art du reportage, sa fascination pour l’islam et son jeu avec les genres féminin/masculin.
Il y a plusieurs textes que l’on peut convoquer pour donner une idée de son écriture de reporter. Mon choix se porte sur Sud Oranais. Envoyée par le journal, L’Akhbar et La Dépêche Algérienne, elle saute sur l’occasion pour repartir vers le Sud : « Un lourd ennui pesait sur Alger, et je me laissais aller dans une somnolence vague, sans joie et sans chagrin, et qui, sans désirs aussi, aurait pu avoir la douceur de l’anéantissement. Tout à coup, le combat d’El Moungar survint, et, avec lui, la possibilité de revoir les régions âpres du Sud : j’allais dans le Sud Oranais, comme reporter… Le rêve de tant de mois allait se réaliser, et si brusquement ».
Elle revendique donc très clairement son statut de journaliste-reporter, ce qui n’est pas une profession exercée couramment par une femme alors. A Aïn Sefra, elle va interroger les survivants des combats : « Un peu fiers d’être « interviewés » – un mot qu’on leur a appris – ils sont un peu intimidés » et c’est le caporal Zolli qui répond à ses questions. La journaliste nous restitue ainsi, avec beaucoup de savoir-faire, le récit de l’embuscade.
Outre ces nouvelles « militaires », toujours transformées en tranches de vie, les « papiers » du reporter sont riches de toutes sortes de détails et de précisions. Dans la grande tradition du réalisme, Isabelle Eberhardt multiplie les notations pour faire vivre un décor, un paysage, un groupe humain. Elle sait qu’elle pénètre là où peu d’Européens l’ont précédée et avec une disponibilité unique, due à son adoption du mode de vie. Sa plume est picturale : elle sait rendre les jeux d’ombre et de lumière, les couleurs, le végétal et le minéral des paysages. Il serait aisé de multiplier les exemples : ainsi de son évocation de « Hadjerath M’guil » ou celles de Figuig : « Les heures s’écoulent, monotones, sur le ksar mourant. Seul, l’ocre mat du rempart, le lambeau de ciel que découpe la porte change, passant du mauve irisé des matins au bleu incandescent des midis, au rouge carminé taché d’or des couchants et aux transparences marines des nuits lunaires. Le soir, la petite porte semble s’ouvrir sur une fournaise dont le reflet ardent descend jusqu’au fond des ruines ».
Ainsi de sa visite aux marabouts et de ce bonheur qu’elle ressent d’être seule mais de partager cette solitude avec son lecteur pour l’assurer en quelque sorte de l’excellence de son observation : « Pas de guide, nulle vision étrangère s’interposant entre mes sens et les choses, nulle explication oiseuse, tandis que j’errais, toute seule, dans ce coin de pays nouveau pour moi ». C’est avec la même précision qu’elle évoquera la mort d’une chamelle ou qu’elle livrera le morceau descriptif obligé de tout voyageur, le marché, à différents endroits de son reportage dont le « Marché d’Aïn Sefra ».
.
Maxime Noiré – Les marchands arabes à Biskra. Isabelle Eberhardt a dédié les Pleurs d’amandiers au peintre orientaliste qui était son ami, « le peintre des horizons en feu et des amandiers en pleurs »
Son réveil au camp des goumiers est possible car elle exerce son métier sous son costume de cavalier arabe qu’elle porte toujours. En ethnologue qui ne se nomme pas, elle traduit les chants des goumiers, comme elle le fera plus loin des mélopées entendues les soirs de Ramadan. Certains de ses relevés ont pu lui servir pour des nouvelles ; d’autres auraient pu être la matière première de textes futurs : « En passant par Aflou, dans le Djebel Amour, je recueillis quelques sujets de contes, et je fus vivement frappée par le caractère de la belle population industrieuse et forte de cette région où s’est conservée l’art du tapis (…) Le siège de Taghit, raconté par un rhapsode arabe, passionnait l’auditoire d’un café maure ». Elle passe sans heurt du portrait du légionnaire qui lit la Bible à la description de la salle longue du maître de la zaouïa. Elle sait aussi évoquer, en un tableau saisissant, les conditions de vie de la communauté juive de Figuig ou de Kenadsa.
Isabelle Eberhardt a une grande attention aux types nationaux, aux types ethniques, nous faisant découvrir la sorte de « Babel » qu’est l’armée coloniale ; quand elle aborde la description des esclaves noirs, elle nous laisse assez perplexe sur l’ambiguïté de ses propos. Elle décrit aussi dans ses articles le fonctionnement d’une « théocratie saharienne », une fumerie de kif, la danse des négresses « au corps mince et souple ». On a, sans aucun doute, pour cette époque – 1903 – un reportage inédit sur le Sud-Oranais. Le côté inestimable, c’est que son don d’écriture est nourri par une implication dans ces lieux qu’elle visite, partageant le quotidien des êtres qu’elle côtoie.
Un autre aspect passionnant à découvrir en lisant les textes de l’écrivaine elle-même et pas seulement ses biographes, c’est la fascination que l’islam a exercé sur elle. Attirée dès sa jeunesse par l’islam, on ne connaît pas la date exacte de sa conversion. Ce qui semble certain, c’est que c’est à El Oued en 1900 – une des années les plus heureuses de sa courte vie –, qu’elle est devenue « Khouan » (membre) d’une des confréries religieuses les plus fermées de l’époque, la Quadriya. Sa connaissance du Coran lui a attiré l’estime des marabouts, en particulier celle de Sidi Hussein ben Brahim, chef religieux de la zaouïa de Guemar, qu’elle fréquente assidûment. Une de ses critiques précise : « Elle est bientôt initiée à la mystique soufie, à laquelle sa nature la prédisposait déjà, initiation qui contribuera largement à l’attitude de plus en plus contemplative, religieuse d’Isabelle. Désormais, elle cherchera cette « unité avec Dieu », but ultime du soufi, quête qui ne va pas toutefois sans contradictions chez la jeune femme » dans la lutte entre son besoin d’ascèse et sa sensualité, contradictions dans lesquelles elle se débat et qu’elle exprime dans ses Journaliers : « C’est l’aube, l’heure radieuse entre toutes au désert. Je m’éveille au murmure grave des mokhazni qui prient dehors, baignés dans la lueur irisée du jour levant ». L’islam qu’Isabelle vit avec volupté, est étroitement lié au soufisme et au nomadisme qu’elle a choisi comme constante de sa vie : « O volupté des logis de hasard où, insouciant, seul, ignoré de tous, on s’hallucine ? Ombre amie des ports provisoires, des haltes longues sur la route ensoleillée du vagabond libre ! Douceur infinie des rêves quintessenciés, dans les abîmes de silence, aux pays d’islam ! ». A Djenan ed dar, elle mesure son « noir cafard » à l’immensité du désert et retrouve ce qu’elle semble chercher : « Et là, au tournant, brusquement, tout change. C’est l’espace sans bornes, aux lignes douces imprécises, ne s’imposant pas à l’œil, fuyant vers les inconnus de lumière ». Elle a une admiration certaine pour les mokhazni car « de tous les soldats musulmans que la France recrute en Algérie, (ils sont) ceux qui demeurent les plus intacts, conservant sous le burnous bleu leurs mœurs traditionnelles. Ils restent aussi très attachés à la foi musulmane, à l’encontre de la plupart des tirailleurs et de beaucoup de spahis ». Lorsqu’elle rencontre des Figuiguiens, elle note : « Ils passèrent devant mon compagnon en burnous bleu et moi et nous jetèrent distraitement le salut de paix qui est comme le mot d’ordre de l’islam, le signe de solidarité et de fraternité entre tous les musulmans, des confins de la Chine aux bords de l’Atlantique, des rivages du Bosphore aux barres du Sénégal. En regardant ces hommes marcher dans la vallée, je compris plus intimement que jamais l’âme de l’islam, et je la sentis vibrer en moi. Je goûtai, dans l’âpreté splendide du décor, la résignation, le rêve très vague, l’insouciance profonde des choses de la vie et de la mort ».
Elle sait rendre, avec une sensibilité extrême les soirs de Ramadan et lorsqu’elle s’introduit dans son texte, c’est toujours avec discrétion mais en laissant entendre une longue familiarité avec ce rite musulman. Mais ce à quoi elle revient toujours comme dans un texte évoquant Oujda, le 27 mars 1904, c’est la conjonction islam/mort/éternité : « Dans une chambre antique, je m’étends sur un tapis et je m’endors. Comme en rêve, dans un demi-sommeil, j’entends une voix indistincte d’abord qui monte du silence angoissant d’Oujda enfin apaisée. La voix monte, monte, s’élevant en des sonorités claires de hautbois, pour finir en une plainte douce, mourante, en un soupir : ce sont des Aïssaouah qui prient et psalmodient leur dikr dans la sérénité pudique de la nuit, cachant la pourriture des choses, et la déchéance des êtres.
Et là encore, c’est, comme au coucher du soleil, une impression de paix immense, d’immobilité, une impression intense de vieil Islam indifférent devant la mort, insoucieux des ruines, poursuivant à travers ces siècles de guerre et de sang son grand rêve serein d’éternité ». C’est dans Sud Oranais aussi qu’on trouve le récit très épuré, puisque jamais la narratrice ne donne ses vraies motivations, des semaines qu’elle va passer à la zaouïa de Kenadsa, lieu d’enseignement de la confrérie des Zianya. Une de ses éditrices écrit : « le cheikh de la confrérie accepte Si Mahmoud il sait pourtant qu’il s’agit d’une femme, mais il respecte sa « demande » et sa connaissance de l’arabe et du Coran. Pendant plusieurs semaines, Mahmoud se consacre à son expérience intérieure, « dans l’ombre chaude de l’islam ». Quelque chose va lâcher en elle, qui l’emporte au-delà des limites du corps et de la sensation. Quelque chose d’indicible ».
Il est vraisemblable qu’elle retrouve là tout ce qu’elle cherche de son rêve d’islam, de son rêve de dépouillement matériel et spirituel, loin des bruits du monde et dans la vie la plus humble possible. Elle a véritablement acquis l’esprit de « soumission » qui est le sens même du mot islam. En même temps cette expérience est bien un témoignage exceptionnel sur l’une des dernières anciennes théocraties sahariennes.
Le dernier point sur lequel nous voudrions nous attarder est celui de son usage du masculin, dans ses écrits et dans sa vie. L’image qui vient immédiatement à l’esprit est celle de l’apparence masculine « arabe » qui fut la sienne durant sa courte vie. Elle s’est véritablement transformée en « cliché » au mauvais sens du terme faisant écran à sa quête véritable dont nous venons de donner une idée. Aventurière au sens noble du terme, elle est loin d’être la première femme à adopter le costume masculin ; ce qui est plus original est d’adopter le costume oriental ou arabe mais il correspond au pays qu’elle a choisi.
Le début du « Premier journalier » commence ainsi et indique que cet « habillement » est conjointement un « habillage » de l’énonciation :
« Cagliari, le 1er janvier 1900.
Je suis seul, assis en face de l’immensité grise de la mer murmurante… Je suis seul… seul comme je l’ai toujours été partout, comme je le serai toujours à travers le grand Univers charmeur et décevant, seul, avec, derrière moi, tout un monde d’espérances déçues, d’illusions mortes et de souvenirs de jour en jour plus lointains, devenus presque irréels.
Je suis seul, et je rêve… »
Sa volonté de s’écrire au masculin est fréquente mais non systématique et ouvre des questions passionnantes sur sa position existentielle, sociale et religieuse. Femme, oui mais femme masquée en homme, pour quelle raison ? Est-ce un refus de sa féminité, refus d’un certain statut des femmes, dans sa culture d’origine et dans sa culture d’élection ? Ici aussi beaucoup de textes pourraient être choisis, comme Journaliers, Au pays des sables et Sud Oranais mais aussi ses fictions, des nouvelles ou son roman inachevé Trimardeur.
Tous ces déplacements, elle les fait habillée (et non déguisée) en homme, en cavalier arabe. Au début, elle avait adopté une tenue masculine citadine tunisienne puis très vite, elle adopta l’habillement du grand sud. Cette apparence qui lui a permis d’aller partout où elle le voulait, lui valut beaucoup d’attaques et de médisances dans le milieu colonial. Le séjour à Ténès où elle dût essuyer une campagne de dénigrement et de harcèlement particulièrement féroce, a laissé un document qu’il faut citer en son intégralité pour comprendre quelle haine pouvait susciter ce « jeu » sur les marques sexuées.
Un rédacteur de L’Union Républicaine, journal à la solde du clan qui avait décidé de la campagne contre Isabelle Eberhardt et d’autres de ses amis au moment d’une élection, en mai 1903, écrit : « Une dame masquée. Un aimable échantillon du sexe auquel nous devons la Belle Fatma et Louise Michel a daigné, d’une plume légère, effleurer dans Le Turco, L’Union Républicaine.
Cette douce créature prétend constater que nous n’avons pas répondu à une lettre de sa blanche main à notre adresse, et nous fournit, en vingt lignes, cent sujets de gaieté.
Elle signe madame Mahmoud Saadi, rue d’Orléansville, Ténès, s’adjoint comme renfort, une demoiselle Eberhardt.
Or, nous avions été mis, par épître recommandée – oui, ma chère -, en demeure de fournir des explications à une dame Ehnni, villa Bellevue, Mustapha, prise en tant que rédactrice – en réalité directrice de L’Akhbar.
Quel lien de parenté unit madame Mahmoud, du Turco, madame Ehnni, de L’Akhbar, mademoiselle Eberhardt, de La Dépêche ?… Y a-t-il là une réédition du mystère de la Sainte Trinité ? Et lorsqu’une madame Ehnni nous écrit de Mustapha, que devons-nous à madame Mahmoud, de Ténès ?
Nous avons souvent rencontré dans les bureaux de l’imprimerie Zamith, la cigarette aux lèvres, un jeune indigène, imberbe, au front rasé, portant un manteau noir fièrement relevé sur l’épaule et faisant sonner de superbes bottes rouges (il s’appelle Mahmoud, nous déclara M. Barrucand, au début de L’Akhbar. C’est mon domestique).
Ce domestique est-il un collaborateur, ce jeune homme est-il une femme, est-ce une demoiselle ou une dame, cette dame s’appelle-t-elle madame Mahmoud ou madame Ehnni ? Habite-t-elle Orléansville ou Mustapha ? Cruelle, ô très cruelle énigme !
Comme il n’est pas d’usage de confier à la poste des lettres à la suscription ainsi libellée : Monsieur X…, mademoiselle Y…, ou madame Z…, quelque part ! nous rendrons raison au sphinx qui nous occupe dès qu’il nous aura appris son adresse véritable, son sexe, son nom légal.
Entre Mahmoud, Ehnni et Eberhardt, entre un homme et une femme, entre une dame et une demoiselle, entre Ténès et Mustapha, il y a vraiment trop de différence et de distance pour nous contenter d’à peu près ».
Aujourd’hui où l’on connaît bien les différents pseudonymes de l’écrivaine et le nom qu’elle s’était donné dans sa vie algérienne et que ceux qui la côtoyaient lui donnaient volontiers, on mesure, par un tel article, le degré de violence et de malveillance qu’elle pouvait soulever et comment, pour l’attaquer, on s’en prenait à cette oscillation intolérable entre le masculin et le féminin.
.
Parfois, au contraire, cette apparence masculine intriguait, fascinait. Robert Randau rapporte les souvenirs de Fernand Carayol, fonctionnaire à la Commune mixte et qui se souvenait très bien de l’arrivée du couple à Ténès, le soir du 7 juillet 1902 : « Mon interlocuteur avait gardé dans sa mémoire le spectacle de l’arrivée en 1902, un soir, de la jeune Russe, à l’Hôtel des Arts, dont il était l’un des pensionnaires. Elle descendit de la diligence à cinq chevaux, qui reliait chaque jour Orléansville à Ténès. Vers 19 heures, il se trouvait à table avec ses commensaux (…) quand un couple d’indigènes proprement vêtu traversa la salle. Quelqu’un remarqua, en voyant que l’un de ces voyageurs était imberbe et avait les mains fines : « Tiens, on dirait une femme ». Et la bonne qui servait murmura : » Oui, c’est une femme, mais elle s’est inscrite au bureau sous le nom de Si Mahmoud ». Ils apprirent de la sorte qu’elle était l’héroïne de ce drame du Sud Algérien dont ils avaient lu naguère les péripéties dans les quotidiens ».
En avril 1903, des journalistes furent invités à une réception lors de la visite du Président de la République Loubet en Algérie. Avec Barrucand, Isabelle Eberhardt fut parmi les convives : « Sa présence parmi ceux-ci, dans son élégant costume de cavalier arabe, suscita un vif mouvement de curiosité chez les reporters qui l’entouraient ; ils l’accablaient de questions dont la plupart étaient saugrenues. Elle souhaita de mettre fin aux légendes épiques imaginées déjà par les publicistes eux-mêmes, ardents à informer le lecteur ébaubi de l’existence à Alger d’un confrère musulman appartenant au beau sexe et vêtu en indigène. Elle refusa d’être considérée en héroïne de roman-feuilleton, échappée à une tentative d’assassinat dans un désert perfide ; elle rédigea une lettre-notice sur sa vie et ses aventures, document qui fut inséré dans La Petite Gironde du 23 avril 1903 ».
Dernier portrait cité, cette fois par elle-même, dans une lettre à son frère Augustin, en 1900 : « D’ici quelques jours, mon cheikh, Si Mohammed El Hachemi, frère du Naïb, et l’esprit le plus prodigieux que j’aie jamais rencontré, sera à Touggourt. Nous irons l’y chercher, Slimène et moi. La poudre parlera, au jour de l’arrivée du grand marabout et les chevaux galoperont dans la plaine de Tèksébet, sous El Oued ! Parmi les cavaliers, tu en verrais un, monté sur un fougueux petit alezan doré… Le cavalier, vêtu de gandouras et de burnous blancs, d’un haut turban blanc à voile, portant à son cou le chapelet noir des Kadria, la main droite bandée avec un mouchoir rouge pour mieux tenir les brides, ce sera Mahmoud Saadi, fils adoptif du grand Cheikh blanc, fils de Sidi Brahim ».
C’est enfin son mari qui « décodera », de la manière la plus simple, ce jeu sur les identités de genres. Il vient se présenter à R. Randau en sa qualité de Khodja de la Commune Mixte, nouvellement nommé et présente ainsi Isabelle : « Je vous présente Si Mahmoud Saadi (…) C’est là son nom de guerre ; en réalité il s’agit de Mme. Ehnni, ma femme ».
.
.
S’habiller autrement est le prix d’une liberté. Isabelle est à Alger, le 23 juillet 1900 et note dans son « Journalier » : « Après une station très courte avec Eugène dans ma chambre, lui parti, je suis allé, seul, à la découverte. Mais mon chapeau me gênait, me retranchant de la vie musulmane.
Alors, je suis rentré, et, ayant mis mon fez, je suis ressorti et je suis allé, avec Ahmed, le domestique, d’abord à la djemaâ el-Kebira…(…) Salué l’oukil de la mosquée (…) Soupe chez El-Hadj-Mohammed, au coin de la rue Jénina. Là, ressenti intensément la joie du retour, la joie d’être de nouveau là, sur cette terre d’Afrique à laquelle m’attachent non seulement les meilleurs souvenirs de ma vie, mais encore cette attirance singulière, ressentie avant de l’avoir vue, jadis, à la Villa monotone. J’étais heureux, là, à cette table de gargote… Indéfinissable sensation, irressentie où que ce soit ailleurs qu’en Afrique ». Il est bien évident qu’en costume européen et plus encore en costume féminin, Isabelle Eberhardt n’aurait pu faire ce qu’elle nous décrit là et qui lui est indispensable.
Son second long reportage, Sud Oranais, dont le manuscrit a été retrouvé dans la boue de l’inondation d’Aïn Sefra où elle a trouvé la mort en octobre 1904, souligne aussi combien l’allure masculine protège et permet de vivre comme on entend vivre. Plus encore que dans Au pays des sables, le contrat qui lit I. Eberhardt à son journal et à ses lecteurs et la connaissance qu’ils ont de son « originalité » sont sensibles. Aussi, les passages où elle se confie sont, en règle générale au féminin. Combien de fois, ne trouve-t-on pas : « j’étais assise… j’étais seule… », ou « j’étais accoudée au petit mur… », alors que, lorsqu’elle se met en scène, c’est au masculin ou pour souligner l’ambiguïté qu’elle provoque chez ceux qui ne sont pas au courant. Ainsi, lorsqu’elle arrive à Hadjerath M’guil, « le chef de poste, un capitaine de la Légion, me regarde, stupéfait. Il ne comprend pas du tout le rapport qu’il peut y avoir entre ma carte de femme journaliste et le tout jeune Arabe qui la lui tend. Nous finissons cependant par nous expliquer».
On la voit ainsi passer très aisément de sa qualité de « reporter de guerre » à celle, essentielle, de « reporter du Sud » dont le pouvoir de pénétration est accru grâce à son statut de musulman. Lorsqu’elle rend compte de sa visite à un marabout de la région où aucun officier n’est rentré, aucun chrétien, elle précise : « Moi, musulmane, on m’y mène, car Sidi Slimane est le grand guérisseur des malades ». Cela donne évidemment un très beau « papier » inédit de journaliste.
Cette ambivalence féminin/masculin parcourt l’ensemble de Sud Oranais. Elle se campe au milieu des hommes car ils la prennent pour l’un d’eux ; ainsi, aucun doute sur le côté de la tente où elle dort ni au sens qu’il faut entendre pour l’adverbe « fraternellement » : « Il fait chaud, sous la tente, dans l’entassement des hommes à demi couchés, accoudés sur les genoux ou sur l’épaule du voisin, fraternellement.
Dans l’autre moitié de la tente, derrière les tentures aux somptueux reflets de laine pourpre, ce sont des frôlements de femmes et des chuchotements qui intriguent vivement mon compagnon. Pourtant, il s’efforce de rester impassible et de ne rien remarquer de ce qui révèle le voisinage des femmes ».
Dans un texte suivant, « Les Marabouts », après avoir décrit et suggéré l’ambiance entre fumeurs de kif où elle s’intègre au « nous », elle se lance dans une de ses grandes envolées lyriques, à nouveau au masculin car ce qu’elle revendique, elle n’a pu le vivre qu’avec le masque de l’autre sexe. Le dernier soir qu’elle passe avec les spahis, soir de ramadan, ils lui demandent avec insistance de rester : « Ils savaient bien, par tant d’indiscrétions européennes, que Si Mahmoud était une femme. Mais, avec la belle discrétion arabe, ils se disaient que cela ne les regardait pas, qu’il eût été malséant d’y faire allusion, et ils continuaient à me traiter comme aux premiers jours, en camarade lettré et un peu supérieur ».
La seconde partie de Sud Oranais est plus tardive et porte sur le printemps et l’été 1904 qu’Isabelle Eberhardt y a passé, d’Aïn Sefra à Kenadsa. Les notations personnelles sont masculines : « j’étais heureux (…) joyeux » ; souvent malicieuses, comme lorsqu’elle rapporte ces propos de légionnaires : « Il est girond, le petit spahi… ». Lors de sa retraite à la zaouïa de Kenadsa, l’ambivalence est vitale pour son projet et sa restitution littéraire, en apparence toute masculine, en confidence, féminine : « Mon guide leur répète ce que Kaddour ou Barka lui a dit que je suis Si Mahmoud ould Ali, jeune lettré tunisien qui voyage de zaouïa en zaouïa pour s’instruire ».
Après son acceptation, elle se confie : « je suis seule » mais dans tous les rapports avec les autres, elle est nécessairement un jeune taleb. Et quand il s’agit de changer une fois encore son costume – on peut supposer que ce n’est pas pour déplaire à Isabelle…–, c’est pour passer du costume « algérien » mal vu dans la palmeraie de Kenadsa, au costume marocain : « En effet, les Marocains abhorrent les Algériens, qu’ils considèrent comme des renégats » et elle développe cette information à partir de ses propres convictions : « Et voilà que ce soir, pour sortir, je me suis transformée en Marocain, quittant le lourd harnachement des cavaliers algériens pour la légère djellaba blanche, les savates jaunes qu’on chausse sur les pieds nus, et le petit turban blanc sans voile, roulé en auréole autour d’une chechiya ».
Lorsqu’elle est parfois effrayée par sa solitude, surtout après ces accès de fièvre qui l’obligeront à retourner à Aïn Sefra, elle restitue cela par un passage où s’entremêlent féminin, pour dire ses angoisses concrètes : « j’étais seule, seule dans ce coin perdu de la terre marocaine… » et masculin, pour dépasser cet état contingent vers une sorte de vérité d’ordre général : « Etre seul, c’est être libre, et la liberté était le seul bonheur nécessaire à ma nature. Alors je me dis que ma solitude était un bien ».
On voit donc, dans ce double reportage qu’est Sud Oranais, combien le costume et le comportement – Isabelle a toute une gestuelle masculine et des habitudes musulmanes –, sont liés à la manière de s’énoncer au masculin ou au féminin en une oscillation intéressante. Le 15 août 1901 à Marseille, dans un état particulièrement désespéré, elle écrit, à quelques lignes de distance : « M’en aller, vagabond et libre, comme je l’étais avant même au prix de n’importe quelle souffrance nouvelles ! (…) m’embarquer humble et inconnue et fuir, fuir enfin pour toujours (…) Certes, je ne suis venue ici que pour pleurer, pour regretter, pour me débattre dans l’obscurité et ses angoisses, pour souffrir, pour être prisonnière ! A quand le départ radieux ? »
Dans Au pays des sables, brèves inspirées de son premier long séjour au Sahara, en 1902, on retrouve cette même variation d’un genre à l’autre. Comme ces textes sont plutôt des nouvelles journalistiques qui ont été publiées dans la presse algéroise et métropolitaine, on peut penser que le jeu est en partie de la séduction et du mystère vis-à-vis des lecteurs, plus conscient que dans ses écrits intimes. Dans le premier texte qui a donné son titre à l’ensemble, la journaliste transmet son amour de l’âme du désert, d’autant qu’elle écrit alors qu’elle est éloignée de sa « patrie d’élection » et dans son « souvenir nostalgique d’exilé ». Le texte suivant évoque un morceau haut en couleurs et pittoresque de la littérature exotique dont Isabelle Eberhardt se tire bien car elle n’est pas simple observatrice mais « acteur » et donc percevant des détails qu’un œil extérieur ne verrait pas. Dans ce « reportage », elle privilégie le « nous » qui masque la différence sexuelle au profit du masculin et qui, en même temps, s’accorde avec son besoin d’intégration, au cœur de sa quête. Elle privilégie aussi les verbes actifs qui dispensent du participe passé et de ses fameux accords. Une seule phrase laisse « voir » sa présence, au masculin, dans une activité impensable pour une femme :
« Toute la folie contenue, toute l’épouvante aussi des chevaux se donnent enfin libre cours, et ils fuient, ils fuient comme s’ils ne devaient plus s’arrêter jamais. L’ivresse de toutes ces âmes violentes et sincères m’a gagné, et, comme les autres cavaliers, j’achève de me griser dans la course folle ».
Le troisième texte, « Soir de ramadan » est très intéressant car évoquant, avec beaucoup de retenue, les premiers temps d’amour avec Slimène, il est entièrement au féminin : « où j’étais allée me perdre un matin » – « Et moi, mélancoliquement, je prolongeais mon jeûne, fascinée par le spectacle unique d’El Oued » – « Là, sur cette pierre, j’étais assise, un soir déjà obscur » et plus loin : « C’est aussi de cette tranquille demeure de Salah ben Feliba qu’après la nuit folle du vingt-huit janvier, passée en des caresses furieuses de part et d’autre et qui fut la dernière que j’étais destinée à passer sous mon toit, je partis, mélancolique, me sachant déjà exilée, mais bien calme, pour la sinistre Behima ».
Il semble qu’ici le masculin vise à renforcer toute la crédibilité de l’informateur qu’est la journaliste aux yeux de son lecteur et à obtenir une information inédite. Mais, en même temps, la journaliste s’affirme comme reconnue par ceux qu’elle veut siens ; ce que confirme bien la fin de l’histoire que le nomade lui a confiée : « Nous nous étions roulés dans nos burnous (…) lui, le nomade (…) moi, la solitaire, que son idylle avait bercée ».
Dans le choix même des personnages de ses fictions et reportages, nés de sa vie ou de ses rencontres, les personnages qui « collent » le plus à ce qu’elle était et à ce à quoi elle aspirait sont des hommes. Trois exemples peuvent en être donnés : le héros de son roman, Trimardeur ; « Le Major » et « L’Anarchiste » d’Au pays des sables. Il s’agit, à chaque fois, de jeunes hommes idéalistes, russes ou français, Dmitri Orschanow, Jacques le major et Andreï Antonoff. Le premier fait tout un parcours de sa Russie natale au port de Marseille, les deux autres pour d’autres raisons mais comme lui, se retrouvent en Algérie. Ils découvrent une autre vie dans ce pays mais leur sympathie pour le peuple arabe les met au ban de leur société et ils repartent ou meurent. Certains de ces personnages sont plus proches que d’autres de l’écrivaine mais la ligne majeure est toujours celle du difficile passage entre deux civilisations et deux cultures non du fait de l’individu mais du fait de l’étroitesse d’esprit des sociétés.
Si Isabelle Eberhardt peint plus volontiers et avec une grande connaissance et familiarité les milieux masculins, les seuls qu’elle ait vraiment connus, son œuvre est également traversée de portraits ou de silhouettes féminines, en trois constantes. Les Françaises ou Européennes de la colonie sont brocardées et tournées en ridicule, particulièrement au moment du procès, de ses séjours à Marseille et des écrits à Ténès puisque c’est alors qu’elle les a le plus côtoyées. Les Algériennes sont vues et « croquées », rarement individualisées, avec la commisération et la sympathie qui caractérisent son regard dès qu’elle observe et décrit le peuple colonisé. Elle voit leur gloire, elle voit aussi leur misère. Elle admire leur port, même avec des guenilles mais elle ne donne pas dans l’exotisme facile, sachant combien cela est faux. Elle sait aussi être acerbe. Mais son écriture de prédilection lorsqu’elle évoque plus longuement et positivement des femmes est pour des marginales ou des exceptionnelles. Les portraits de prostituées sont d’une grande humanité et sont très nombreux, ce qui s’explique aussi par le mode de vie d’Isabelle Eberhardt. C’est un milieu qu’elle a côtoyé et dont on peut penser qu’il la fascinait à cause de l’hypocrisie de sa mise à l’écart.
Les femmes exceptionnelles, ce sont les maraboutes. Ainsi cette brève consacrée à Lella Khaddoudja dans Sud Oranais, belle histoire que lui conte Ba Mahmadou et à partir de laquelle, elle rêve : « A mon tour je me mets à rêver à cette Lella Khaddoudja inconnue, et qui a sans doute une âme un peu aventureuse, puisqu’elle a rompu, de sa propre volonté, avec la routine somnolente de la vie cloîtrée de ses pareilles, pour aller ailleurs recommencer une existence nouvelle, sous un autre ciel. Que s’est-il passé dans le cœur de cette maraboute voyageuse ? » Celle qui se détache est, bien sûr, Lella Zeyneb de la zaouïa d’El-Hamel à Bou-Saada et qu’elle évoque dans ses Journaliers : si elle brille par l’absence de son portrait, elle illumine la vie d’Isabelle par son enseignement sur lequel celle-ci reste très discrète : « De ce voyage, rapide comme un rêve, de Bou-Saada, je suis revenue plus forte, guérie de la maladive langueur qui me minait à Alger… » écrit-elle le 7 juillet 1902, de retour à Ténès. Ce passage ouvre un long paragraphe sur le sens de son nomadisme qui est recherche mystique : « Cette idée amènerait à penser que la vraie figure de ce grand Univers est à jamais insaisissable et inconnue… Cette figure absolue serait en effet la face de Dieu… » Dix-huit mois plus tard, le 31 janvier 1903, Isabelle note son passage à Bou-Saada : « Hier, nous sommes rentrés d’El-Hamel vers 3 heures du soir, Ben Ali et moi. Toutes les fois que je vois Lella Zeyneb, j’éprouve une sorte de rajeunissement, de joie sans cause visible, d’apaisement. Je l’ai vue hier deux fois dans la matinée. Elle a été très bonne et très douce pour moi et a manifesté la joie de me revoir. (…) Tout – et moi-même – est changé radicalement…. ».
Avec Isabelle Eberhardt se dessine la construction d’un personnage auquel elle s’est identifiée pour vivre son idéal, refusant le rôle féminin de sa société d’origine mais aussi de sa société d’élection puisqu’elle y a vécu en tant que musulman. Peut-être que, dans cette société, eut-elle consenti à reprendre les marques extérieures de son sexe si elle avait eu le temps de devenir, comme Lalla Zeyneb, une femme hors statut !
« Isabelle Eberhardt, femme au destin en forme de météore, écrivain controversé, continue à susciter intérêt et fascination (…) Pour apprécier les nouvelles d’Isabelle Eberhardt, il convient sans doute de les situer à la fois dans leur époque et dans l’itinéraire passionné et généreux de leur auteur » écrit à son propos Tahar Djaout. Car elle est une figure prégnante de la littérature algérienne, sans parler des articles nombreux et des biographies écrites à son sujet. Ainsi le nom d’Isabelle Eberhardt surgit dans le roman autobiographique de Jean Sénac, en 1989, avec le qualifiant complice et affectueux de « ma folle du désert », aux côtés des noms de Genet et d’Artaud, trois noms lourds de symboles pour le poète. Tahar Djaout la classe ainsi : « premier écrivain algérien de langue française » ou « écrivain européen indigénophile. »
Ce second qualifiant a un parfum d’exotisme non l’exotisme de pacotille qui met des signes convenus sur un pays mais l’exotisme, au sens fort du terme, qui traduit en écriture une expérience existentielle qui tient l’équilibre entre l’appartenance d’origine et l’appartenance nouvelle désirée : « Ce qui différencie radicalement Isabelle Eberhardt des autres écrivains français séduits par le désert, comme André Gide par exemple, c’est qu’elle a renoncé à tous ses antécédents, ses vieilles attaches européennes pour vivre quotidiennement et jusqu’à la mort cette fascination qui n’était pas dénuée de douleur. […] En outre, l’auteur de Yasmina possède une connaissance des coutumes et de la culture algériennes qui la distingue résolument des écrivains de passage. Cette connaissance est une connaissance de l’intérieur. »
.
.
Quatre écrivaines l’inscrivent dans leur écriture dans des textes écrits entre 1986 et 2005. Dès 1986, Dans Lettres parisiennes, échange épistolaire entre elle-même et Nancy Huston, Leïla Sebbar cite assez longuement Isabelle Eberhardt dans une de ses missives en choisissant des qualifiants comme « singulière, aventurière et mystique […] les mystiques et les saintes m’attirent comme les guerrières.» Première esquisse qui met le doigt sur ce qui retient l’écrivaine française née en Algérie, la marginalité, l’attrait pour les Arabes et l’islam soufi. L’intérêt est affirmé mais il n’y a pas véritablement de généalogie littéraire revendiquée, plutôt une curiosité signalée qu’elle veut partager. Elle y revient plus substantiellement en 2005 dans un recueil de nouvelles, Isabelle l’Algérien – Un portrait d’Isabelle Eberhardt. Le premier texte est un récit biographique, sous le titre de l’appellation dont on dit qu’elle était celle de Lyautey, « Cette bonne Mahmoud ». Leïla Sebbar raconte Lyautey écoutant Isabelle racontant Lella Zeyneb, la célèbre maraboute de la Zaouïa d’El Hamel. Les autres textes, partant d’une nouvelle, la réécrivent ou la prolongent. Comme le dit la 4ème de couverture : « On entend la voix et les mots des humbles (soldats indigènes, paysans, bagnards, nomades, prostituées, légionnaires) et des dignitaires qu’elle a croisés (officiers de Saint-Cyr dans les Bureaux arabes, chefs de confréries musulmanes, fils de grande tente, hommes de lettres » algérianistes »). On entend aussi le Spahi Slimène, le mari d’Isabelle, Lyautey, Lella Benben à Alger, Lella Zeyneb à El Hamel. »
Il en va autrement en 1999 de la trace de ce nom dans un texte particulièrement cité et connu d’Assia Djebar, dans Ces voix qui m’assiègent, « Entre corps et voix ». Revenant sur son parcours d’écriture et de création et ayant introduit dès le début du texte la référence au « désert ancestral », le dernier tiers a pour titre, justement, « Repères dans le sable ancestral ». On y lit :
« Le sable, je n’ai pas encore couru au désert
Isabelle, dès le début de ce siècle
En grandes foulées avides
Elle, l’aventurière
La rimbaldienne des ksours et des oasis
La convertie « dans l’ombre chaude de l’islam »
comme on a dit pour elle,
En quelques années rapides de sa jeunesse
de son ivresse
Isabelle nous a toutes précédées…
Écriture de sable pour celle qui, à la fin, s’est noyée
La miraculée
La ressuscitée.
Mon sable à moi sur des décennies
S’effeuille dans la voix de cendre
Des ancêtres ».
Citation assez lourde de sens… « Isabelle nous a toutes précédées », « nous les Algériennes » qui ont pris le départ, qui ont pris la plume. Ici, clairement se dessine une généalogie littéraire et la nécessité de l’échappée.
Il revient à Maïssa Bey d’établir une complicité avec elle, dans sa ville d’origine, Ténès. Les points d’information sur le passage d’Isabelle Eberhardt à Ténès s’inspirent sans doute du très attachant livre de Robert Randau, évoqué précédemment. Essaimant des informations biographiques, Maïssa Bey les interprète, livrant ainsi sa « version » de la position marginale de la jeune femme : « Ténès. Traversée accidentellement par une femme venue d’un pays lisse et neutre. Peut-être trop lisse. Trop neutre pour une femme comme elle. Pour une bâtarde nourrie de laits amers, trop amers. […]
Elle, Isabelle. Maintenant, en écriture, ombre retrouvée, reconnue, nommée. Quelque vision peut-être, entrevue dans la fragile lueur d’un matin, dans le pas entendu aux confins d’un rêve étranger surgi de ces lectures mêmes. »
Isabelle est un modèle d’audace, mais aussi modèle né de la forêt de ses lectures, la fascination s’affirme pour le mystère de « la cavalière », de la femme hors normes, de celle qui n’a pas hésité « à tenter de franchir les portes interdites ». « Mais elle, Isabelle, ou Mériem, ou Nicolas, ou bien encore Mahmoud, homme ou femme, chrétienne ou musulmane, illuminée ou simplement lucide, anarchiste, libertaire ou en quête d’absolu, à la recherche d’improbables racines, qu’a-t-elle trouvé ? A-t-elle fini par rejoindre, à Ténès, Aïn Sefra ou ailleurs, la cohorte de ceux qui n’ont dans les mains, dans les mots, que leurs « rêves pareils à des cavaliers noirs » ? »
C’est évidemment la tentative d’assimilation profonde qui est la plus significative et la plus troublante. L’écrivain qui devient personnage de fiction acquiert alors une force pérenne d’être inscrit dans une écriture contemporaine. C’est ce que fait Malika Mokeddem. Dans Le Siècle des sauterelles, de 1992, elle est une référence fondatrice de la protagoniste qui éclaire son désir de création. Tout fait écho : le parcours et la halte, Kenadsa, Aïn Sefra et le désert, Yasmine et Mahmoud. Car les « noms » d’Isabelle Eberhardt ou de ses personnages sont attribués aux deux protagonistes. La référence est encore renforcée par le nom de la mère qui est assassinée au début du roman, Nedjma, rattachant ainsi Isabelle Eberhardt à la lignée du fondateur du roman algérien et maghrébin, Kateb Yacine. La citation d’Isabelle Eberhardt va des allusions les plus explicites aux analogies significatives. Pratiquement au centre du roman, le long passage qui lui est consacré éclaire les cent cinquante premières pages et guident la lecture des cent quarante suivantes. Tout prend sens et au fil des pages, on sent partout l’ombre portée d’Isabelle Eberhardt. Référence centrale du roman, Le Siècle des sauterelles consacre Isabelle Eberhardt comme figure-guide pour la liberté d’une femme et de sa création. Cette référence dynamise une écriture réaliste en introduisant une forte symbolisation de l’univers fictif proposé.
Au terme de ce parcours, il est assez évident, que c’est plus la stature exceptionnelle d’Isabelle Eberhardt que son écriture qu’ont retenue les lettres algériennes. Est-ce étonnant ? On doit rappeler, encore une fois, que l’œuvre d’Isabelle Eberhardt est une œuvre « nomade » au sens éditorial du terme. Ses textes sont dispersés car publiés de son vivant dans des revues et journaux, et toutes les rééditions ont suscité des contestations, depuis les interventions importantes de Victor Barrucand aux erreurs dues à tel ou tel manuscrit : c’est une œuvre non encore fixée et la plus accessible est aujourd’hui les quatre tomes aux éditions Joëlle Losfeld ; ainsi que la reprise par Martine Reid de quelques nouvelles d’Amours nomades dans la collection « Femmes de Lettres » chez Gallimard en 2008.
Mais au-delà de ces incertitudes éditoriales, c’est une œuvre jeune, une œuvre de débutante qui prenait ses marques et sa texture avec de plus en plus d’évidence. C’est une écriture passionnante à lire et à analyser avec ses emprunts, les influences reçues – celle de Loti par exemple que les derniers textes commencent à dépasser –, celle d’une écriture qu’on peut qualifier de picturale en la mettant en regard avec des peintres orientalistes – Eugène Fromentin, Maxime Noiré –, celle de l’influence de l’écriture du reportage sur l’écriture plus littéraire – ses textes sont une mine sur l’Algérie coloniale et sur le rapport littérature et journalisme –, celle de l’adhésion à un mysticisme religieux qui n’a pas fini de faire réfléchir.
Les romancières algériennes ne se sont pas trompées sur son importance : « Isabelle nous a toutes précédées… », « Elle, Isabelle. Maintenant, en écriture, ombre retrouvée, reconnue, nommée », « Un songe où une femme marche et écrit. Une roumia habillée en bédouin (…) Yasmine marche sur ses traces, dans la même contrée et dans l’écrit ». Pour elles, elle est une ombre vers laquelle se diriger, une audace à atteindre, un absolu sans compromis, au-delà des assignations identitaires frileuses et sclérosantes. On pourrait qualifier cette écrivaine journaliste de femme rebelle mais en comprenant sa révolte comme profondément individuelle. Elle n’a jamais cherché à avoir des adeptes, ni à fédérer autour d’elle des émules. Sa rébellion s’est traduite par le refus des conventions. Il ne faut pas oublier que nous avons affaire à une jeune femme, entre ses 20 et 27 années, qui était gouailleuse et aimait aussi faire des farces ! En adoptant un mode de vie au masculin, sans renier son rôle féminin sexué, en le faisant dans une autre culture, Isabelle Eberhardt a véritablement franchi des frontières dans le contexte de son époque. Contrairement à ses consœurs d’Europe adoptant le vêtement masculin, elle a choisi, avec le vêtement, un autre mode de vie, une autre civilisation, une autre spiritualité. Les photographies que l’on a d’elle, très connues aujourd’hui, font bien la différence entre l’apparat et l’intégration : tenue d’apparat, celle qui est la plus souvent reprise en couverture de ses œuvres ou en blason de biographies ; tenue d’intégration, plus bouleversante parce que plus modeste et proche du quotidien, celle de la photo que Robert Randau légende comme étant la dernière où on la voit dans une tenue beaucoup moins prestigieuse et plus commune, assise contre un mur, cigarette à la main et regardant à terre.
.
.
Elle fut fidèle à la devise adoptée à son adolescence : « J’irai solitaire jusqu’à ma mort », elle a été en quête d’elle-même dans un pays et une région de ce pays, le grand Sud, où elle semble avoir pu aller jusqu’au bout de sa foi. Elle a été à la recherche, par le déplacement et le voyage, d’un autre sens à la vie et à la mort qui hante ses écrits, à une spiritualité. C’est en ce sens que ses textes sont à lire pour suivre les cheminements d’une expérience de vie exceptionnelle. C’est après sa première visite à Lalla Zeyneb à la zaouïa d’El-Hamel que avons évoquée qu’elle note, dans son journal, ce passage si souvent cité car emblématique de ce que l’on croit comprendre de cette personnalité complexe : « Nomade j’étais quand, toute petite, je rêvais en regardant la route, la blanche route attirante qui s’en allait, sous le soleil qui me semblait plus éclatant, toute droite vers l’inconnu charmeur… nomade je resterai toute ma vie, amoureuse des horizons changeants, des lointains encore inexplorés, car tout voyage, même dans les contrées les plus fréquentées et les plus connues, est une exploration ».
.
https://diacritik.com/2016/12/23/isabelle-eberhardt-1877-1904-une-identite-dans-lalterite/
.



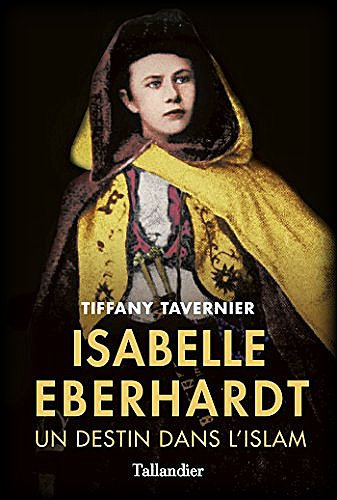

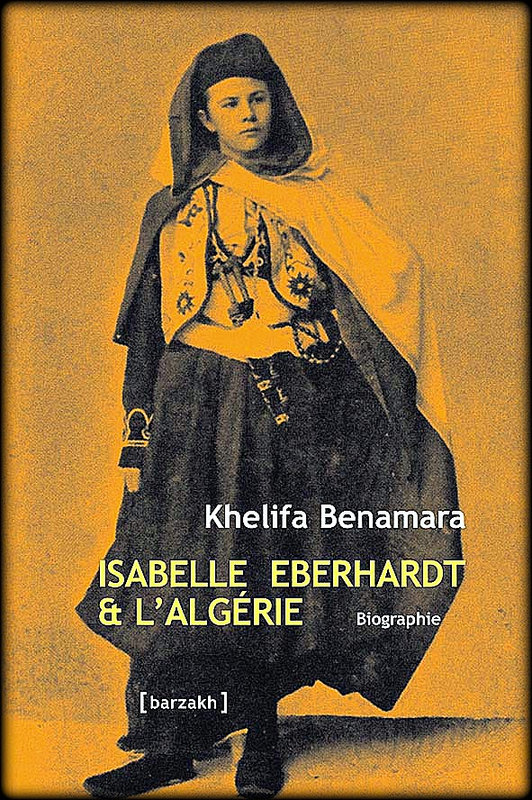



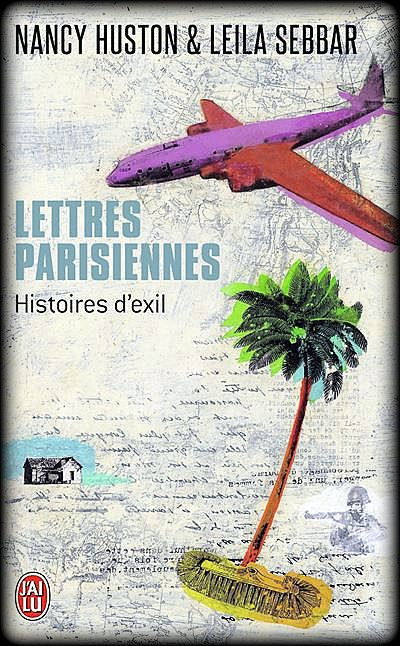


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F35%2F310520%2F132181069_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F21%2F310520%2F131626004_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F24%2F88%2F310520%2F128381144_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F72%2F28%2F310520%2F127999404_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F94%2F310520%2F107760948_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F61%2F310520%2F43564574_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F56%2F52%2F310520%2F14861473_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F43%2F45%2F310520%2F17556980_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F20%2F310520%2F14527083_o.jpg)